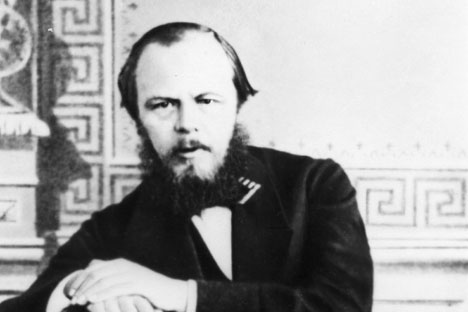
Dostoïevski et la condition humaine
Travail de synthèse reposant sur les lectures reprises sous « bibliographie »
Me Gaston Vogel à la tribune du Jeune Barreau :
Le 26 juin 1970, devant une soixantaine de bâtonniers, de présidents des Associations professionnelles et de présidents des Conférences de Jeunes Barreaux de France, Belgique, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Angleterre et Suisse réunis à Luxembourg, Me Gaston Vogel, avocat-avoué à Luxembourg, prononçait un discours, ayant pour sujet : « Dostoïevski et la condition humaine ».
Avec une connaissance profonde du sujet, Me Vogel réussit à dégager toute l’actualité du message du grand écrivain russe, précurseur et inspirateur des grands noms de la littérature moderne. En résumé, voici les extraits essentiels de ce discours.
La soif de vivre
Le soir du 28 janvier 1881 Dostoïevski quittait ce monde dans la pleine lumière de son esprit.
La Russie entière prit le deuil du grand disparu. Une foule immense accompagna la dépouille mortelle à la Laure d’Alexandre Nevsky, cette même foule que quelques mois auparavant, le 8 juin 1880 exactement, il avait mis dans un enthousiasme délirant quand il proclama dans un discours sur Alexandre Pouchkine la communion universelle des hommes. Il avait passé par tous les cercles de l’enfer humain.
En 1839, son père, médecin, fut assassiné pas ses serfs sur le chemin de Darovoe à Tchermachnia.
« Mon père en colère avait injurié ses paysans. L’un d’eux, plus hardi que les autres, répondit grossièrement, et effrayé des suites que pourrait avoir son audace, cria : «Allons ! Les gars ! Zigouillons-le !»En poussant des cris, une quinzaine de paysans se ruèrent sur mon père et en un clin d’œil l’achevèrent…
On le retrouva plus tard sur le chemin étouffé sous les coussins de la voiture.
Le laboureur Makarov portait sur le père de l’écrivain un jugement sévère : « Cet homme, disait-il, était une bête fauve. »
Deux mois après cette mort qu’il a apprise avec retard, Dostoïevski, âgé de 18 ans, fut terrassé par la première grave crise d’épilepsie. Cette maladie ne le quittera plus désormais. Toute l’œuvre portera les traces du Haut-Mal. Goliadkine, le double ; Mourov, le bandit-sorcier ; Kirilov, l’insurgé ; Nelly, la petite victime ; Mychkine paré de toute sainteté ; Smerdiakov, le tueur ; Aliocha, l’élu, tous portent cette maladie soit comme condamnation, soit comme privilège.
Dostoïevski, dont la santé était ruinée par les nombreuses crises comitiales était très attaché aux prodromes des attaques. C’est qu’il avait l’étrange passion des abîmes. C’est encore le goût des abîmes qui poussait Dostoïevski dans les casinos de jeu, à Roulettenburg, Saxon les Bains, Wiesbaden, et ailleurs. Avec quel tremblement, avec quel battement de cœur n’écoutait-il pas les cris du croupier : 31, rouge, impair et passe … ou bien, quatre, noir, pair et manque. Avec quelle avidité ne regardait-il pas la table de jeu, parsemée de louis, de friedrichs, de thalers, les pièces d’or empilées que le râteau du croupier répandait en tas brulants comme du feu.
« Déjà en approchant de la salle de jeu », devait-il dire, « dès que je perçois le tintement des pièces qui s’entrechoquent, je ressens des convulsions. »
Il y a en Dostoïevski une force qu’Yvan Karamazov caractérisera en plaisantant : toute l’inconvenante soif de vie des Karamazov.
Le 23.04.1849 Dostoïevski est arrêté par la police tsariste pour prétendues menées subversives. Une grande curiosité intellectuelle et une certaine générosité du cœur l’avaient poussé à prendre contact avec le cercle de Petrachevski, cercle qui conspirait contre la monarchie et le féodalisme. Le tribunal militaire siège pendant six semaines et le 16 novembre 1849 Dostoïevski est condamné à la peine de mort. Le 22 décembre 1849, jour fixé pour l’exécution, le tsar Nicolas Ier se permet une cynique plaisanterie. Une effroyable mise en scène aura lieu. On emmène les prisonniers à la place d’armes du régiment Sémionov. Là on leur donne lecture de la condamnation à mort, on leur donne la croix à baiser et on leur fait la toilette de mort (chemises blanches). Puis on en met trois au poteau pour l’exécution. Dostoïevski fait partie du deuxième groupe. Il n’a plus que des secondes à vivre. « J’avais le temps d’embrasser Plechtcheiev, Dourov, qui étaient près de moi et de leur dire adieu. Brusquement on sonnait la retraite, on ramenait ceux qui avaient été attachés au poteau, puis on leur lisait la décision de sa Majesté de nous accorder la vie. »
« Vous pouvez », dira-t-il plus tard par la bouche de « L’Idiot », « amener un soldat en pleine bataille jusque sous la gueule des canons, il gardera l’espoir jusqu’au moment où l’on tirera. Mais donnez à ce soldat la certitude de son arrêt de mort, vous le verrez devenir fou ou fondre en sanglots. La véritable souffrance ne provient peut-être pas des blessures, mais de savoir avec certitude que dans une heure, dans dix minutes, dans une demi-minute, puis tout de suite, l’âme quittera le corps et qu’on ne sera plus un être humain. Tuer pour punir d’un meurtre est un châtiment qui dépasse incommensurablement le délit. Un assassinat commis en application d’une sentence est plus affreux qu’un assassinat commis par un brigand. »
Le crime gratuit
Ce fut ensuite le chemin pour la Sibérie, la katorga. Le 23 janvier 1850 Dostoïevski arrive au bagne d’Omsk. Là-bas, dans la Maison des Morts, Dostoïevski se sentira affreusement seul. Tous ses efforts pour s’intégrer à la communauté des criminels demeureront vains. Ils le considèrent comme un étranger. Un jour qu’il avait omis de participer à quelque revendication des détenus, il cherche à se faire pardonner ce manque de camaraderie et se trouve devant un homme sincèrement étonné : « Mais en quoi seriez-vous notre camarade ? »
Je le regardai, il ne saisissait absolument pas ce que je lui voulais. Je compris alors que, fussé-je le plus grand coupable du bagne, et condamné à la détention perpétuelle, jamais ils ne verraient en moi un camarade. Il n’y avait dans sa question pas ombre d’ironie, de méchanceté, mais une naïveté sincère, un étonnement de bonne foi. « Tu n’es pas mon camarade. Suis ton chemin, nous suivrons le nôtre. »
Seul, abandonné de tous, empêché d’écrire, Dostoïevski tournera toutes ses forces vers la réflexion. Sa méditation portera principalement et d’abord sur la valeur intrinsèque du crime. Dans le milieu clos et atroce du bagne il procède à une véritable expérimentation in vivo du crime. Le crime paraîtra à Dostoïevski comme la suprême épreuve que l’individu puisse s’imposer à lui-même en bandant sa volonté à l’extrême, jusqu’à transgresser la limite.
Notons entre parenthèses que le mot russe « criminel » – prestoupnik – signifie étymologiquement transgresseur. Tous les grands romans de Dostoïevski s’organiseront autour d’un crime. Le premier de ses romans, « Crime et Châtiment », sera entièrement consacré à l’étude de la théorie du crime gratuit, commis pour s’éprouver. Dans « L’Idiot », Mychkine pressentira dès la première rencontre la fatalité du crime passionnel qui pèse sur Rogochine. Dans les « Possédés » l’agitation nihiliste aboutira au crime politique. « Les frères Karamazov » (les quatre, si on y ajoute Smerdiakov) seront hantés par la tentation du parricide.
En mars 1859, Dostoïevski est mis sous la surveillance de la police secrète, surveillance qui ne cessera plus jusqu’à sa mort. Même dans ses exils forcés à l’étranger on ne le laisse pas en paix. Ses allées et venues, sa correspondance, sont étroitement surveillées. Les Popes de l’église orthodoxe (et en particulier celui de Genève) jouent ici un rôle peu flatteur.
Dostoïevski s’en plaint amèrement dans plusieurs lettres adressées au poète Maïkov.
A ces souffrances physiques, morales et politiques, s’ajoutent les tracas familiaux et la misère. Et malgré tout, Dostoïevski essayait toujours de se réconcilier avec la vie, mais la vie refusait toute réconciliation.
Le 16 mai 1878 meurt à l’âge de trois ans son fils Aliocha : « Fédor » dit Anna
Grigorievna, « fut horriblement frappé par cette mort. Il aimait particulièrement Aliocha, d’un amour presque maladif, comme s’il prévoyait qu’il le perdrait bientôt. Il était particulièrement affligé du fait que l’enfant était mort d’épilepsie. »
« Si tous doivent souffrir », s’écrira Ivan Karamazov, « afin de concourir par leur souffrance à l’harmonie éternelle, quel est le rôle des enfants ? On ne comprend pas pourquoi ils devraient souffrir eux aussi au nom de l’harmonie. Pourquoi serviraient-ils de matériaux destinés à la préparer ? Un mauvais plaisant objectera que les enfants grandiront et auront le temps de pécher, mais il n’a pas grandi, ce gamin de huit ans, déchiré par les chiens. Je comprends comment tressaillira l’univers, lorsque le ciel et la terre s’uniront dans le même cri d’allégresse, lorsque tout ce qui vit ou qui a vécu, proclamera : « Tu as raison, Seigneur, car tes voies nous sont révélées. » Sans doute alors la lumière se fera et tout sera expliqué. Le malheur, c’est que je ne puis admettre une solution de ce genre. Si la souffrance des enfants sert à parfaire la somme des douleurs nécessaires à l’acquisition de la vérité, j’affirme d’ores et déjà que cette vérité ne vaut pas un tel prix. Je ne refuse pas d’admettre Dieu, mais très respectueusement, je lui rends mon billet. Ce qu’il me faut, c’est une compensation quelque part dans l’infini, mais ici-bas, une compensation, sinon je me détruirai. Et non une compensation quelque part dans l’infini, mais ici-bas, une compensation que je vois moi-même. »
L’accueil réservé à Dostoïevski
La Russie soviétique a oublié Dostoïevski. Les nouveaux ingénieurs de l’âme chargés de donner à la nation un nouvel idéal littéraire déclaraient la guerre au dostoïevskisme déprimant ; le dostoïevchtchina, comme on s’exprime avec mépris, ne pouvait servir le marxisme-léninisme. Dans les guides pour touristes de la Ville de Leningrad on ne se souvient de lui que pour être complet.
En Occident, Dostoïevski ne recrutait que lentement ses lecteurs. L’intelligence salonnière le rejetait. Il n’était pas commode à saisir. Il était par ailleurs trop chaotique. Les critiques, tout en lui reconnaissant une manière de génie, gênés par son énormité, le présentaient en demandant pardon au lecteur. On servait d’abord des versions procustement mutilées, et ce n’est que très lentement que l’œuvre entière parut chez divers éditeurs, au compte-gouttes, volume après volume.
Eh oui, il était trop différent de tout ce qu’on connaissait alors. On avait du mal à le cataloguer, à le ranger dans la vitrine : « Notre esprit, dit André Gide, a besoin de savoir à quoi s’en tenir, après quoi, l’on n’a plus besoin d’y aller voir, ni d’y penser. Nietzsche ? A oui, le surhomme. Soyons durs. Vivre dangereusement. – Tolstoï ? La non-résistance au mal. – Ibsen ? Les brumes du Nord. – Darwin ? L’homme descend du singe.
Malheur aux auteurs dont on ne peut réduire la pensée en une formule. Le gros public ne peut les adopter (et c’est ce que comprit si bien Barrès lorsqu’il inventa, pour couvrir sa marchandise, cette étiquette : La Terre et ses Morts. »
Chez Dostoïevski il est difficile de se payer de mots, de trouver la formule. Il est très complexe et très étrange.
Ce qui le distingue fondamentalement et d’abord de la grande majorité des auteurs européens et russes, c’est sa façon de créer ses personnages.
« L’idée d’un personnage étant donnée dans son esprit, il y a pour le romancier, dira Jacques Rivière, deux manières bien différentes de la mettre en œuvre ; ou il peut insister sur sa complexité, ou il peut souligner sa cohérence ; dans cette âme qu’il va engendrer ou bien il peut vouloir produire toute l’obscurité ou bien il peut vouloir la supprimer pour le lecteur en le dépeignant. »
Dostoïevski lui respecte et protège les ténèbres. Il suggère les abîmes – il n’organise jamais – il ne recherche pas l’unité psychologique en donnant ici un coup de pouce, en retranchant là quelques traits divergents. – Ses personnages, et il en a créé tout un peuple, évoluent sans aucun souci de demeurer conséquents avec eux-mêmes. Ils cèdent à toutes les contradictions, à toutes les négations. Ils sont profondément alogiques, inconséquents. Ainsi les héros de Dostoïevski aiment en haïssant et haïssent en aimant.
Le troublant c’est la conscience que garde chaque personnage de son double et la crainte de ne pouvoir maintenir longtemps en eux la même humeur et la même résolution pousse les héros à une brusquerie d’action déconcertante. Ils ne sont jamais entiers, mais scindés, tiraillés en tout sens. Opposés l’un à l’autre, ils s’opposent en même temps à eux-mêmes. Chez Dostoïevski rien n’existe en soi. Tout est relatif et l’enjeu est l’aspiration de l’homme, jamais assouvie à se dégager du relatif pour atteindre à l’absolu.
Les héros de Dostoïevski portent en eux une nouvelle inquiétude, une nouvelle sensibilité qu’ignoraient les personnages de Tolstoï, de Tourguénev et de Gontcharov. Ils se meuvent dans de nouvelles dimensions, dans le monde d’aujourd’hui, où tout est fracassé et où on ne parvient pas à modeler en une forme solide les gravats et les décombres. Ils évoluent dans les ombres des paysages urbains. On les voit rôder sur les quais de la Néva, dans le corrosif brouillard qui asphyxie la Ville de St-Pétersbourg. La nature est absente de leurs univers. Parfois le soleil couchant les éclaire par quelques rayons obliques. La plupart du temps il vente, il neige, il brouillasse. Engagés dans le sous-sol, ils s’affrontent avec une violence croissante. Tout en évoluant dans le quotidien le plus plat, ils ne cessent de participer de l’ailleurs. Lourdement chargés, ils luttent sur plusieurs fronts : extérieur, intérieur et supérieur.
Le message de Dostoïevski
Me Vogel, après avoir situé Dostoïevski, son âme complexe et sa nature tourmentée, s’attacha ensuite à dégager le message que nous apporte le grand écrivain russe. Pour Me Vogel ses romans sont d’une actualité brûlante, bâtis sur des thèmes qui nous sollicitent avec une insistance qu’ils n’avaient pas il y a cinquante ans. Toute la littérature et la philosophie modernes ont puisé dans Dostoïevski : Gide, Kafka, Proust, Sartre, Faulkner, Camus ont trouvé chez lui des formes de romans inédites, aptes à rendre les mouvements de l’âme moderne. Des philosophes comme Rozanov, Vladimir Soloviev, Chestov, Berdiaëv ont scruté ses attaches avec l’Apocalypse ou avec l’existentialisme.
Nietzsche a subi l’influence de Dostoïevski à tel point qu’il est permis de dire que ce qui est obscur dans les romans de Dostoïevski s’éclaire à la lumière des ouvrages du philosophe allemand. A un moment où Nietzsche était encore étudiant et rêvait d’idéals sublimes, Raskolnikov se plaçait déjà « Jenseits von Gut und Bös ». Chez Dostoïevski l’homme est toujours au centre. Tout est pour lui et arrive pour lui. Les événements ne sont pas imposés par des forces inconnues, mais se présentent comme le résultat du choc de sa volonté avec l’idée qui l’habite, et le monde extérieur. Néanmoins à aucun moment l’action ne va se perdre dans l’atmosphère raréfiée d’un roman à thèse. Le plan intellectuel est doublé d’un plan passionnel.
Dostoïevski était au plus haut degré impressionnable et enthousiaste. Les pensées les plus générales et les plus abstraites produisaient souvent sur lui un grand effet. Il sentait et vivait pour ainsi dire ses pensées. Artiste d’abord, il pensait en images et se laissait guider par les sentiments.
Devant l’immense richesse de l’œuvre dostoïevskienne force nous est de nous limiter aux thèmes les plus significatifs.
L’homme du XXe siècle a acquis au prix de mille souffrances de grandes libertés dans tous les domaines, politique, social, économique. Il a acquis d’étonnantes connaissances scientifiques. Jamais auparavant il n’a été aussi maître des lois de la nature que maintenant. Et pourtant en dépit de tous ces progrès, qui au début du XIXe siècle constituaient encore le but suprême de ses aspirations, il reste profondément insatisfait. L’homme du Moyen-Age vivait dans un monde dont les coordonnées lui étaient parfaitement connues. Il ne pouvait s’égarer ou se perdre qu’en se mettant volontairement en marge du tracé. L’homme moderne par contre naît égaré et perdu. Il se sent déçu, car et pour la première fois dans son histoire il a la sensation d’être seul…seul dans le silence éternel des espaces infinis.
Chez Dostoïevski et pour la première fois dans l’histoire de la littérature mondiale, l’homme apparaît accablé par le poids de sa propre civilisation, hanté par ses complexes biologiques et historiques, obsédé par sa solitude et sa liberté. Les héros de Dostoïevski ont le sentiment que le passé est mort, que le granit, l’inaltérable en un mot, tout ce qui servait aux hommes à fonder leurs « a priori » et leur « solidité », que tout cela a cessé d’exister.
Que peut l’homme assujettir à la force obscure, insolente et stupidement éternelle qui régit son univers ?
Que peut-il, seul, face aux menaces de la tarentule ?
Comment est-ce que je vivrais sans Dieu ? Toute l’œuvre de Dostoïevski pivote autour de cette question fondamentale, posée par Dimitri Karamazov. Sa vie durant l’écrivain en a subi les tortures et nous le voyons se révolter constamment contre la réponse et les dernières convictions qu’elle ne cesse de lui imposer. La question hante l’esprit des acteurs de premier plan et les pousse aux pires extravagances, voire à la folie. Raskolnikov, Kirilov, Stavroguine, Verkhovensky, Versilov, Mychkine, Hippolite, Yvan Karamazov, tous périssent sous la gravité de la réponse. Au fil des romans « Crime et Châtiment », « L’Idiot », « Les Possédés », « Les Frères Karamazov » nous assistons à une sûre et violente aggravation de la pensée.
Les positivistes répondront à Dimitri que l’homme finira par survivre, car il est bon, raisonnable et libre ; qu’il a donc les moyens nécessaires pour composer avec le monde. La raison lui donnera les apaisements nécessaires. Devant les impératifs de la logique, l’homme finira par s’incliner. Sa bonté naturelle, son libre-arbitre, et les possibilités de progrès offertes par la raison le guideront sur les difficiles chemins de la vie.
Avec cette témérité qui n’appartient qu’à ceux qui ont perdu tout espoir, Dostoïevski fait table rase de ces « a priori » et procède à une analyse implacable de la nature humaine. Il connaît l’homme mieux que quiconque. Il est le seul, dira Nietzsche, qui m’ait appris quelque chose en psychologie.
Arrivé au bout de son enquête sur la nature humaine, Dostoïevski s’écrie le cœur serré d’angoisse : « L’homme est large, trop large, je le rétrécirai. Dans son cœur il y a tant de choses accumulées que Dieu lui-même en restera stupéfait lorsqu’elles lui seront dévoilées au Jugement Dernier. » Passons en revue les principales questions sur lesquelles portait l’enquête. Et d’abord : Le prétendue bonté de l’homme a-t-elle jamais existé, ou n’est-ce qu’une fiction, un mensonge ?
Dostoïevski ne fait pas confiance à l’homme. Il le définit un être à deux pattes et profondément ingrat. L’ingratitude n’est même pas son principal défaut. Son principal défaut, c’est son mauvais caractère, qu’il a gardé constant depuis le déluge universel. Une analyse de l’histoire universelle le confirme dans sa vision pessimiste : « Il est impossible de dire », souligne-t-il, « que l’histoire de l’homme est raisonnable : dès la première syllabe, la langue vous fourchera. Regardez donc autour de vous. Le sang coule à flots, galement même, comme du champagne. »
Et puis la 2e étape de l’enquête. La raison ? Peut-elle raisonnablement être considérée comme une chance de l’homme dans un univers régi par une force insolente obscure et stupidement éternelle ?
C’est dans les « Notes prises au sous-sol », que Dostoïevski pose le diagnostic de la raison humaine ? Nous abordons ici l’étude d’une œuvre mal connue de l’écrivain. Elle est étrange, tout y étonne : la construction, le style, le sujet. La première partie comporte la confession de l’homme du « souterrain », qui est une voix qu’on ne peut situer ni dans le temps, ni dans l’espace. Dostoïevski y examine les problèmes les plus graves de la philosophie et son commentateur, Motchoulski, a pu écrire que par la puissance et la hardiesse de la pensée il ne le cède en rien ni à Nietzsche, ni à Kierkegard. L’œuvre date de 1864. Nous voyons naître dans ces pages le rongeur intellectuel qui sous peu envahira la littérature mondiale.
Que vaut la raison ? Cette question préoccupe au plus haut point le sombre héros du sous-sol. Il tient en mains une balance. La raison pèse lourdement sur l’un des plateaux, inerte, immobile avec toute sa suite d’évidences traditionnelles et éternelles ; sur l’autre il jette d’une main fiévreuse, tremblante des impondérables : ses outrages, ses humiliations, son épouvante, son enthousiasme, la beauté, etc. Et l’homme du souterrain éclate d’un rire homérique : « Deux fois deux font quatre, messieurs, ce n’est déjà plus la vie, c’est la mort, une impudence. J’admets que ce soit une chose excellente, mais s’il faut tout avouer, je vous dirai que deux fois deux cinq est aussi une chose charmante. Pourquoi est-on si convaincu que seul le normal est nécessaire ? La raison ne se trompe-t-elle pas ? Il se peut fort bien que l’homme aime autre chose que le confort … Je suis pour mon caprice et pour qu’il me soit garanti quand il faudra. »
Voilà lâché le mot capital : Le caprice, la toute simple capacité de vivre selon sa sotte volonté. C’est cela qui distingue l’homme des autres animaux. Ce n’est pas tant la raison. Elle lui impose des limites… les limites de la logique. Or l’homme défend avant tout son caprice, et il le défendra contre la raison, contre les syllogismes, contre les intérêts et les avantages que lui dictent des argumentations logiques.
L’homme se dressera toujours contre la muraille de pierre de la nécessité. Le héros du sous-sol ne raisonne pas ou plutôt il raisonne bien en raillant et en tirant la langue : « Certes la raison est respectable, mais elle n’est que la raison et ne satisfait que la faculté raisonnante de l’homme, alors que ses désirs sont une manifestation de la vie dans sa totalité, c’est-à-dire la raison, plus les démangeaisons. »
« Il importe avant tout à l’homme d’avoir le droit de souhaiter pour lui-même les choses les plus absurdes. C’est que cette absurdité, ce caprice peuvent être pour nous autres plus avantageux que tous les avantages et en particulier lorsqu’ils nous sont manifestement nuisibles et contraires aux saines déductions de notre raison, car ils maintiennent ainsi en nous ce que nous avons de capital et de plus cher ! Notre personnalité et notre individualité. »
Kant ne savait pas questionner ainsi. Bien rare, dira Léon Chestov, furent au cours de l’existence historique de l’humanité ceux qui posèrent de semblables questions.
Telle est sommairement résumée l’hallucinante analyse faite par Dostoïevski de la nature humaine. Le résultat est angoissant. La raison, cette dernière chance de l’homme, est faible, débile, elle se trouve en opposition avec la vie elle-même et Dostoïevski l’appelle avec ironie « euclidienne ».
Reste la liberté : Où peut-elle mener tiraillée par les exigences du caprice ? Que peut l’homme avec sa liberté qui le dresse toujours contre les limites de la raison ? Où seront à la mort de ses Dieux les limites de son Caprice ?
Dostoïevski a peur devant ce « monstre de rêves » qu’est l’homme. La liberté de l’homme, cette terrible liberté, comme dit Kirikov, l’entraîne trop loin et provoquera sa perdition. Le caprice pousse à la destruction.
Dostoïevski est profondément bouleversé par le résultat de son enquête. Sa lucidité l’a effrayé. Il voudrait la voir abolie : « Une conscience trop clairvoyante, je vous assure Messieurs », déclare-t-il par la bouche du héros du sous-sol, « est une maladie, une maladie très réelle. Une conscience ordinaire nous suffirait plus qu’amplement dans notre vie quotidienne, une conscience ordinaire, c’est-à-dire une portion égale à la moitié ou au quart de la conscience octroyée à l’homme cultivé de notre siècle et qui pour malheur, habite Pétersbourg, la plus abstraite, la plus préméditée des villes qui soient sur la terre, car il y a des villes préméditées et il y en a d’autres qui ne le sont pas. »
Dans ses conclusions Me Vogel cite cet entretien entre Fjodor Pavlovitch Karamazov et ses fils Yvan et Aliocha, entretien qui fait surgir une ultime fois la question suprême qui avait si douloureusement agité Dostoïevski : quel est le destin de l’homme et cheminement sans les astres ?
« Yvan, dira le dépravé et débauché père Karamazov, Dieu existe-t-il ou non ?
Non, il n’existe pas.
Aliocha, Dieu existe-t-il ?
Oui.
Yvan, et l’immortalité existe-t-elle ? Une immortalité quelconque, une toute petite immortalité ?
Non, rien.
Rien du tout ?
Rien du tout.
Un zéro absolu ou bien tout de même quelque chose ?
N’y aurait-il pas une parcelle ?
Non un zéro absolu.
Aliocha, y a-t-il une immortalité ?
Oui, mon père.
Dieu et l’immortalité existent bien ?, ensemble ?
Oui, c’est sur Dieu que repose l’immortalité.
Hm… Ce doit être Yvan qui a raison. Seigneur, quand on pense, combien de foi et d’énergie cette chimère a coûté à l’homme en pure perte, depuis des milliers d’années.
Qui donc se moque ainsi de l’humanité ? »
Livres consultés :
Bakhtine Mikhaïl – La poétique de Dostoïevski. Seuil, 1970.
Barscht Konstantin – Dostoïevski, du dessin à l’écriture romanesque. Hermann, 2004.
Catteau Jacques – Dostoïevski. L’Herne, 1973.
Catteau Jacques – La création littéraire chez Dostoïevski. Institut d’études slaves, 1978.
Catteau Jacques – Dostoïevski, Correspondance (3 Vol.). Bartillat, 2003.
Doerne Martin – Tolstoj und Dostoïevski, zwei christliche Utopien. VR, 1969.
Dostoïevski Fiodor – Die Brüder Karamasov. Ammann, 2003.
Dostoïevski Fiodor – Journal d’un écrivain. Gallimard, 1972.
Dostoïevski Fiodor – L’adolescent, les nuits blanches, le sous-sol, le joueur, l’éternel mari. Gallimard, 1956.
Dostoïevski Fiodor – Les carnets du sous-sol. Babel, 1993.
Dostoïevski Fiodor – Les démons, carnets des démons, les pauvres gens. Gallimard, 1955.
Dostoïevski Fiodor – Les frères Karamazov, les carnets des frères Karamazov, Niétotcha Niézvanov. Gallimard, 1952.
Dostoïevski Fiodor – L’idiot, les carnets de l’idiot, humiliés et offensés. Gallimard, 1953.
Dostoïevski Fiodor – L’œuvre intégrale (10 Vol.). Piper&Co, 1977.
Dostoïevski Fiodor – Nouvelles et récits, édition intégrale. L’âge d’homme, 1993.
Dostoïevski Fiodor – Récits, chroniques et polémiques. Gallimard, 1969.
Dostoïevski Fiodor – Raskolnikoffs Tagebuch, mit unbekannten Entwürfen, Fragemente und Briefen zu « Rastonikof » und « Idiot ». Piper&Co, 1928.
Dostoïevski Fiodor – Drei Novellen. Gustav Kiepenhauer, 1916.
Dostoïevski Fiodor – Der Idiot. Ammann, 1996.
Dostoïevski (Gattin) – Die Lebenserinnerungen der Gattin Dostojewskis. R. Pieper & Co, 1925.
Edvokimov Paul – Gogol et Dostoïevski ou la descente aux enfers. Desclée de Brouwer, 1961.
Gide André – Dostoïevski. Gallimard, 1989.
Gourfinkel Nina – Dostoïevski, notre contemporain. Calmann-Lévy, 1961.
Griworavitch et autres – Dostoïevski vivant. Témoignages. Gallimard, 1972.
Grossman Leonid – Dostoïevski. Parangon, 2003.
Ingold Felix Ph. – Dostoïevski und das Judentum.
Kariakine Y. – En relisant Dostoïevski. Pour le 150e anniversaire de la naissance de Dostoïevski, 1971.
Kaus Otto – Dostoïevski und sein Schicksal. E. Laubsche, 1923.
Kaus Otto – Dostoïevski, ein Versuch. Piper, 1916.
Kjetsaa – Dostojewskij Sträfling – Spieler – Dichterfürst. Casimir Katz, 1985.
Komnen Becirovic – Dostoïevski un Contemporain. Annuaire 9 ASSOSS, 1912 – 1962.
Lauth Reinhard – Die Philosophie Dostoïewskis. Piper, 1950.
Madaule Jacques – Dostoïevski. Editions Universitaires, 1956.
Maurina Zeuta – Dostjewski, Menschengestalter und Gottsucher. M. Dietrich Verlag, 1960.
Miller F., Eckstein F. Dostoïevski à la roulette. Gallimard, 1926.
Motchoulski C. – Dostoïevski, l’homme et l’œuvre. Payot, 1963.
Nötzel Karl – Dostoïevski. Haessel-Verlag, 1925.
NRF – Album Dostoïevski. Gallimard, 1975.
Powys J.C. – Dostoïevski. Bartillat, 2000.
Rehm Walter – Jean Paul – Dostojewski zur dichterischen Gestaltung des Verglaubens. Vandenhoeck, 1962.
Rolland Jacques – Dostoïevski. La question de l’autre. Verdier, 1983.
Rothe Hans – Dostoïevskij und die Literatur. Vorträge zum 100. Todesjahr des Dichters 12.10.1989 – 14.10.1989.
Schubart Walter – Dostoïevski und Nietzsche. VitaNova, 1939.
Segaloff Tim (Dr.) – Die Krankheit Dostoievskys. Reinhardt/München, 1907.
Souslova Apollinaria – Mes années d’intimité avec Dostoïevski. Gallimard, 1959 – 1960.
Sperber Manes – Wir und Dostoiewskij. Eine Debatte mit Böll, Lenz, Malraux, Nossack. Hoffmann & Campe, 1972.
Steiner George – Tolstoï ou Dostoïevski. Seuil, 1963.
Volguine Igor – La dernière année de Dostoïevski. De Fallois, 1994.